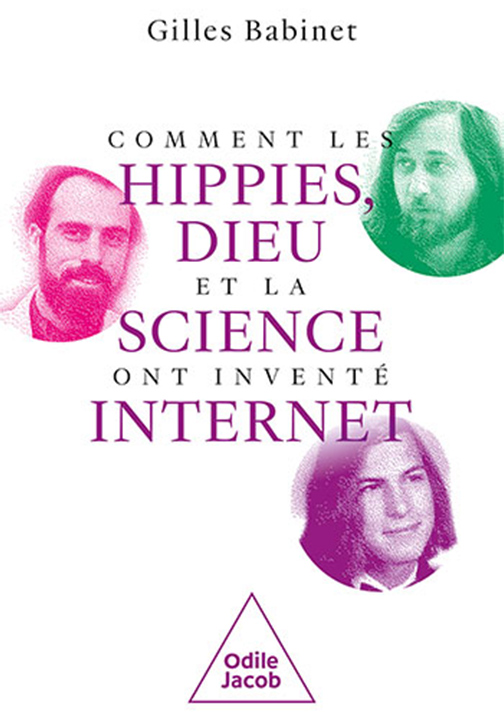 Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé internet
Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé internet
Selon Gilles Babinet
Internet occupe désormais dans nos vies une place incommensurable. Certes le mot est fort, mais pour beaucoup d’entre nous, internet intervient à tous les carrefours. Notre société en est déjà profondément imprégnée. « Internet est une technologie systémique par nature. Ses conséquences sur notre organisation sociale et économique, notre intimité, notre rapport à l’autre, sont incalculables… Il n’est pas impossible que les historiens évoquent un jour cette invention comme l’une des grandes révolutions totales – anthropologiques – de l’histoire humaine » (p 194), écrit Gilles Babinet, auteur du livre : « Comment les Hippies, Dieu et la Science ont inventé internet » (1). Or, l’apparition d’internet remonte à quelques décennies seulement. C’est dire la puissance et la rapidité de la force inventive qui s’est manifestée dans cette irruption. Ce fut une véritable épopée dont Gilles Babinet, entrepreneur pionnier, coprésident du Conseil National du Numérique, représentant de la France auprès de la Commission européenne en tant que « digital champion » nous retrace ici l’histoire.
Cette histoire est née aux Etats-Unis dans le berceau californien à une époque où un mouvement communautaire et holistique battait son plein. Si le titre du livre correspond à cette époque originale, il est loin de refléter le contenu de l’ouvrage, car celui-ci nous rapporte l’histoire d’internet dans toute sa durée jusqu’à aujourd’hui. Et si le récit décrit les circonstances de l’apparition d’internet dans le double contexte de l’effort militaire américain et du mouvement social et culturel avec la figure emblématique des hippies, il ne se contente pas de nous rappeler ce mythe fondateur, il nous rapporte l’histoire qui a suivi pendant plusieurs décennies. Car, au total, manifestant pour sa plus grande part, un dynamisme américain, l’histoire s’est déroulée en plusieurs étapes. Le mouvement a perdu sa dimension sociale dans la poussée conservatrice des années 1980, marquée par l’élection du président Reagan et il a été happé par la montée de l’individualisme. Cependant, l’expansion s’est poursuivie à grande allure et la pratique d’internet s’est répandue dans le monde entier.
En 1989, un changement majeur est intervenu. Internet s’est ouvert au commerce. De grands plateformes « interagissant avec la multitude » se sont développées rapidement. La mise en exploitation des données recueillies s’est accompagnée de la poursuite du nombre d’usagers. L’auteur nous décrit les menaces résultant du dévoiement d’internet à travers l’appât du gain, la captation des mentalités et l’abus de pouvoir. Ce tableau est sombre. Cependant l’auteur est bien placé pour nous montrer des ripostes. Et il suscite notre espoir en ouvrant un horizon.
Pour contrer les dévoiements, nous avons besoin d’un imaginaire mobilisateur. Et si l’écologie avait une grande place dans le mouvement fondateur, la révolution environnementale requiert une convergence avec les ressources d’internet. En quelque sorte, il nous faut forcer le passage.
« Aujourd’hui, la contrainte climatique nous impose un effort collectif sans équivalent… Il sera difficile d’affronter ce défi en ne comptant que sur une somme d’individualités, tout simplement parce que nos usages, nos modes de vie doivent évoluer de façon forte. Nous savons qu’une technologie, à elle seule, ne suffira pas à établir cette coordination. En revanche, cette technologie aiguillée par la contrainte environnementale, devrait naturellement se polariser comme elle l’a toujours fait dans le passé, et induire de nouvelles formes d’organisation sociale, de nouveaux modes de collaboration » (p 227). On peut souhaiter et attendre une conjonction entre la nécessité écologique et internet. Cette jonction pourrait avoir pour conséquence de « remettre le projet initial des pères de la révolution cybernétique des années 1960 à sa place initiale : celle des technologies collaboratives… » (p 11).
Ce livre de Gilles Babinet est remarquablement informé. Il nous décrit pas seulement les différentes étapes dans leur enchainement, mais aussi des personnalités marquantes, les acteurs qui, en grand nombre, ont joué un rôle dans cette partition. C’est aussi une histoire des idées, voire des philosophies et des visions du monde qui se sont manifestées dans ce contexte. Bref, nous voici maintenant pourvu d’un livre de référence sur internet, de surcroit bien écrit. Il nous rapporte une histoire qui nous tient en haleine malgré une technicité qui nous dépasse parfois. Voici un livre majeur pour comprendre internet, c’est à dire pour comprendre notre temps.
Les grandes phases de l’évolution
Gilles Babinet nous montre comment « les idéologies dominantes ayant parcouru les années 1950 jusqu’à aujourd’hui ont façonné l’internet tel que nous le connaissons » (p 7).
Au départ, prévaut « la cybernétique qui, dans les année 1950, est une discipline essentiellement militaire ». Ainsi, en 1948, une étude de Claude Shannon : « Une théorie mathématique de la communication » répond aux besoins de transport et de calcul de l’état-major américain (p 8). « Ce monde militaire sera, deux décennies durant, à l’épicentre de la cybernétique ». Dans le même temps, une agence dépendant de l’armée, mais très autonome, l’Arpa réalisait « une première infrastructure de transport de données (Arpanet), aboutissant à l’établissement d’un premier réseau d’une douzaine de sites » (p 21). C’était l’émergence d’un « proto-Internet ».
Mais, à cette même époque qui, nous rappelle Gilles Babinet, se situait « au cœur des Trente Glorieuses », et en Californie où s’exerçait une capillarité entre les différents innovateurs, « les communautés hippies rêvaient de refonder l’Amérique ». Celle-ci « connaissait des mouvements sociaux tels qu’elle n’en a jamais connu depuis ». Ce mouvement se mit en veine de « voler le feu cybernétique des mains du complexe militaro-industriel ». « L’objectif était alors de disposer d’un pouvoir décentralisé, créatif et autonomisant ». « Cette intention réussira au-delà de toutes les espérances, avec l’émergence de la micro-informatique, directement initiée par quelques protagonistes du mouvement hippie. Son effet de traine sera remarquablement long : d’une certaine façon, Wikipédia et la mouvance « open source » sont de lointaines conséquences de cette ère » (p 9).
« Puis survint la révolution conservatrice avec l’élection de Reagan, de Thatcher et les crises pétrolières. Les rêves de communauté se dissoudront peu à peu dans le projet conservateur, pour lequel l’entreprenariat et la réussite individuelle sont des valeurs cardinales. C’est l’ère des marchands, des start-up de la bourse, des fonds d’investissement et de la montée en puissance du Web. Son apogée, ce sera le « cloud », dont l’une des caractéristiques clef est de concentrer d’immenses quantités de richesses tout en dévoyant la promesse de décentralisation. Au XXIe siècle, non seulement la révolution numérique semble avoir été accaparée par quelques méta-entreprises aux valorisations se comparant à la richesse produite par de grandes nations… » (p 9-10).
Ainsi le climat idéologique ambiant est morose et il y a
une grande défiance. L’auteur le constate : « L’avènement du 5G, vu comme un symbole d’un consumériste numérique, a été l’expression d’un rejet parfois de façon spectaculaire, et même violente ».
Alors, où allons-nous ? Le tableau est d’autant plus sombre que la désinformation prolifère sur internet en menaçant la démocratie.
Gilles Boutinet ouvre un horizon : la jonction de la révolution écologique et de la communication internet « avec pour conséquence probable de remettre le projet initial des pères de la révolution cybernétique des années 1960 à sa place initiale : celle des technologies collaboratives » (p 11).
Le rôle majeur de la vision du monde. Comment les technologies influent sur les mentalités
Les technologies ne sont pas neutres. Elles influent sur les mentalités. On doit y prendre garde. « Les technologies façonnent notre rapport à l’autre, à la réalité. Comme l’observait le philosophe Jacques Ellul, elles définissent de façon essentielle la relation que l’humanité entretient avec le réel. Elle peut profondément restructurer la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Elles déterminent la façon dont nous interagissons avec l’univers » (p 12).
A cet égard, Gilles Babinet nous apporte un exemple remarquable parce qu’il nous rejoint dans notre expérience quotidienne. Ainsi nous parle-t-il de sa grand-mère qui, dans son enfance, allait chercher le lait dans une ferme voisine à une époque où il en restait encore une dans un quartier parisien. « Elle me fit observer, que de toutes les techniques qu’elle avait vu naitre pour prendre leur ampleur, c’était le réfrigérateur qui l’avait le plus perturbée. De son point de vue, cet appareil révolutionnaire avait largement participé à faire disparaître le monde d’avant : une société de solidarité ». En effet, « dans la mesure où la nourriture ne pouvait pas être conservée au delà d’une ou deux journées, il était impératif de pouvoir donner ce qu’on avait en trop à ses voisins de palier ou de l’immeuble. Elle me conta comment au sein de son immeuble, on ne cessait ainsi de s’entre-alimenter… La réciprocité était de mise si bien qu’au bout de quelques temps, chaque visage de l’immeuble devenait familier… ». « On peut facilement concevoir qu’une société reposant sur des principes de solidarité, pour ainsi dire quotidiens, aura par définition une plus forte capacité d’intégration… Une technologie anodine – le frigidaire – peut donc avoir des conséquences significatives sur les relations entre les individus composant une société, en arrêtant brusquement les interactions structurées par l’entraide alimentaire » (p 11-12).
Evidemment, l’usage d’internet a une grande influence « sur la façon dont nous interagissons avec les autres, mais aussi avec l’univers ». A ce sujet, on trouvera matière à réflexion dans le livre de Gilles Babinet. Dans les derniers chapitres, il met en évidence les dérives d’internet et leurs conséquences : inégalités galopantes, individualisme exacerbé, captation de l’attention. L’auteur pointe sur les maux attribués aux réseaux sociaux (p 142-144). Un usage excessif des réseaux sociaux produit des effets indus. « Des travaux de recherche menés au Royaume-Uni ont révélé que les interruptions et les distractions persistantes produisaient un effet très sensible sur notre psychisme. On note une réduction du QI. Une autre enquête conclut : « Cette contrainte sociale issue de la technologie induit une importante adaptation physiologique et génère un stress cérébral récurrent » (p 141). Des recherches ont montré que des plateformes numériques pouvaient susciter une captation de l’attention. En 2013, dans un article, un éthicien Tristan Harris a publié un article dans lequel il déclarait que Google, Apple et Facebook avaient la responsabilité de s’assurer que l’humanité ne passe pas ses journées enfouie dans un smartphone, propos qui créa une immense polémique au sein de Google et lance une forme de débat critique qui perdure encore aujourd’hui » (p 143). Les réseaux sociaux suscitent beaucoup d’interrogations. Frances Haugen écrit ainsi : « Les réseaux sociaux n’ont certainement pas inventé la désinformation ni la violence, mais ils sont conçus de telle sorte qu’ils donnent à l’un et à l’autre un puissance disproportionnée, et cela ne devrait en aucun cas être possible, de façon industrielle dans une société saine » (p 144).
Mais internet, ce n’est pas seulement la puissance des grandes plateformes, c’est le tissu des relations qui s’est étendu dans le monde, qui traverse les frontières, mais qui rapproche aussi des proches, des amis dans leur vie quotidienne. Dans sa dimension relationnelle, internet abrite une activité religieuse et spirituelle (2). C’est un démultiplicateur de la recherche comme le support d’un travail commun. Comment aurions nous fait face à l’isolement infligé par l’épidémie de covid sans la communication qu’internet a rendu possible ? Aujourd’hui, notre monde a changé
Le temps des hippies
Gilles Babinet nous rapporte l’histoire d’internet dans ses différentes étapes et la manière dont celles-ci se relient les une aux autres. En renvoyant au livre, nous rapporterons seulement quelques moments de cette histoire, La période fondatrice se situe en Californie dans les trois décennies d’après-guerre. Différents milieux, non sans communiquer entre eux, y ont participé : l’armée engagée dans la « guerre froide », les grandes universités californiennes, les communautés hippies… Une séquence du livre est intitulée : « Le temps des hippies ».
« Les groupes socialement homogènes – militaires, chercheurs, auteurs d’ouvrages et de films de science fiction, hippies – se sont superposés dans le même espace géographique. Si leurs aspirations différaient largement d’un groupe à l’autre, ils se rejoignaient par plusieurs points. Ainsi, d’une croyance commune à l’existence d’une forme d’harmonie supérieure quelle que soit l’obédience religieuse des uns et des autres : les militaires s’attachaient à la Bible, les hippies à la Bhagavad-Gita et les chercheurs à la transcendance qu’ils percevaient dans leurs équations, mais, dans l’ensemble, tous se rejoignaient dans une adulation du progrès. Car l’histoire des Etats-Unis est largement tissée par l’entreprenariat, par une aspiration collective de millions d’individus à croire en des lendemains meilleurs. Des conquérants qui ne pouvaient s’appuyer que sur leurs communautés immédiates… Le principe de liberté restait également une valeur commune… » (p 41-42). Cette culture s’exprime à travers « de nombreux auteurs aux univers bigarrés : Kerouac, Ginsberg, Burroughs, tous emblématiques d’une volonté d’émancipation radicale ». C’est également un moment où « d’importantes avancées sociales sont acquises » : lutte contre les discriminations raciales, création de dispositifs sociaux… » (p 42). L’auteur évoque le lien entre l’épopée technologique des années 1960 et 1970 et la manière dont le cinéma s’est largement approprié les symboles technologiques les plus évidents de la cybernétique. Ainsi mentionne-t-il le film : « Odyssée de l’espace » (p 46).
« Le début des années 1970 marqua l’avènement de l’ère du microprocesseur qui cristallisa rapidement l’intérêt de quelques acteurs ayant mesuré le potentiel de cette rupture technologique… Une nouvelle génération d’entrepreneurs s’est emparée du microprocesseur pour concevoir une nouvelle génération d’équipements et d’usages informatiques » (p 48). Steve Jobs apparaitra dans ce contexte. De son activité, sortira le Macintosh, « un instrument très éloigné de tout ce que connaissait ce monde de l’informatique traditionnelle, notamment parce qu’il autorisait un design soigné et était doté d’une interface graphique ne nécessitant pas de saisir des lignes de codes » (p 49). Et voici une nouvelle étape : « Socialement accepté, révolutionnaire sans pour autant remettre en cause l’ordre social, économiquement émancipé et en pleine croissance du fait de la loi Moore et plus tard d’Arpanet, ce mouvement recycla sans difficulté quelques uns des protagonistes désormais assagis de la vague précédente » (p 49).
Cependant, revisiter cette époque, c’est découvrir combien la culture associée à l’internet naissant est étendue dans sa gamme d’intérêt et rejoint notre actualité par ses préoccupations écologiques.
Kevin Kelly fonda une des publications phares de la communauté techno-hippie : « The Whole Earth Catalog » qui traitait alors du retour à la terre, de musique, de conception d’ordinateurs personnels, ou encore de respiration yogique. Cette ligne éditoriale connut un succès important atteignant plus de 1,5 million d’exemplaires vendus en 1971 » (p 51). L’auteur nous en décrit le contenu par le menu : techniques de construction de cabanes en rondins de bois, médecine chinoise, moyens de produire soi-même son énergie solaire, commande de graines biologiques et d’appareils de toutes sortes, chroniques de livres… » (p 52). Par la suite, « en 1991, Kelly et un associé fondèrent « Wired », une revue emblématique de la tech et de la Silicon Valley, qui sera diffusée à plusieurs centaines d’exemplaires à son apogée. Si Wired a adopté un ton beaucoup plus consumériste, elle n’en a pas moins continué avec constance à défendre le potentiel écologique de la technologie » (p 54).
On peut inscrire le mouvement de « l’open source » qui commence dans les années 1980, dans la traine de l’esprit collaboratif qui a prévalu dans les débuts d’internet (p 66-74).
L’expansion d’internet
Gilles Babinet nous présente l’histoire d’internet, étape par étape, dans un récit très circonstancié auquel nous renvoyons.
Dans les années 1980 apparaît une révolution conservatrice marquée par l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher en 1979 et 1980. L’agenda conservateur, hostile aux syndicats, évolua vers une politique de libre échange, une globalisation, qui, dans les termes où elle fut menée, celui d’un nouveau capitalisme anglo-saxon, aboutit à « une désindustrialisation massive des pays occidentaux » (p 64) et finalement à l’appauvrissement des travailleurs de l’industrie.
Cependant, la nouvelle technologie porte cette globalisation. « La microinformatique californienne qui avait au départ été idéalisée comme un outil d’autonomiser des communautés alternatives, qui prétendait rapprocher les gens pour créer un monde nouveau et plus solidaire, s’est trouvée investie d’une autre mission : servir de facteur d’émancipation individuelle, de réussite économique et de renouveau de l’Amérique » (p 65).
En 1989, Internet s’ouvrit au commerce. « Les années 1990 ont ainsi représenté la première phase d’émergence économique d’Internet tandis que quelques inventions achevèrent de rendre son accès populaire… Peu à peu, les internautes apprirent à utiliser les listes de diffusion, les e-mails, les sites web, puis le commerce électronique et la livraison à domicile. Amazon et Yahoo se lancèrent en 1994, puis Google en 1998. C’était l’ère de l’Internet 1.0, un internet élémentaire, essentiellement descendant » (p 82). Si la puissance financière résidait à l’est des Etats-Unis, un écosystème unique en son genre se développa dans la Silicon Valley. Cependant, notamment en raison d’une influence libertarienne, une opposition larvée à la régulation se manifestait, une attitude ayant de lourdes conséquences à long terme.
Une nouvelle étape, Internet 2.0 est caractérisée par le règne des plateformes. A ce sujet, on a pu évoquer « une architecture de participation » (p 110). « Cette vision devint réalité grâce à l’émergence des technologies du Cloud et de technologies comme Javascript qui permet de rendre les pages Web considérablement plus dynamiques et créatives qu’auparavant. Facebook sera évidemment la plus emblématique des sociétés qui ont su capitaliser sur ces technologies de plateformes sociales au sein desquelles des communautés s’agrègent par centres d’intérêt, si divers soient-ils, et produisent des contenus thématisés. Il peut s’agir, comme chacun sait, d’une cellule familiale, d’un club de pêche à la ligne, d’amis d’une même promotion de lycée, etc. » (p 111).
L’auteur nous rapporte une recherche selon laquelle on découvre qu’au sein d’un réseau d’individus, il existe « deux types de relations : des liens forts et des liens faibles. Granovetter démontre que les liens faibles, plus nombreux et plus souples sont déterminants dans l’efficacité d’un système social » (p 111). Effectivement, il y plusieurs degrés d’engagement dans un réseau. Désormais, ces plateformes interviennent auprès d’une multitude. « Les plateformes interagissant avec la multitude peuvent avoir une infinie variété d’engagement. Chacune met en œuvre différentes dynamiques pour inviter à la participation » (p 114). Gilles Babinet décrit les différents genres de participation dans leur grande variété. Une autre caractéristique des plateformes est « l’économie des rendements croissants ». « Un chercheur, Metcalfe, est passé à la postérité pour sa théorie qui postule que l’utilité d’un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs… Plus le nombre d’ordinateurs est élevé, plus les interactions entre les utilisateurs deviennent pertinentes. Et inversement, plus les coûts de mise en œuvre de ces technologies sont faibles et plus les données prennent de la valeur ». (p 117-118).
« De fait, les technologies numériques ne sont efficaces que lorsqu’il est question de passage à l’échelle, à très grande échelle. Si l’on ajoute dix autres utilisateurs, la valeur du réseau commence à prendre sens ; les données crées par les premiers peuvent être valorisées par ces dix autres » (p 118). « La loi de Metcalfe fut reprise et réinterprétée de différents manières dont celle des « rendements croissants », l’idée que l’économie numérique était structurellement différente de celle qui précédait, qu’elle allait induire une croissance élevée à faible inflation (ou même à inflation nulle)… » (p 119). La croissance demande de forts investissements au départ et requiert ainsi du temps pour s’affirmer. Ainsi, pour Amazon, entre la date de fondation et le moment où l’entreprise fit ses premiers vrais profits, il ne s’écoula pas moins de quatorze années » (p 119). Aujourd’hui, Amazon –hors Chine – est devenu leader mondial en son domaine. L’auteur souligne la particularité de ce mode de développement. « Dans le cas des plateformes numériques, une fois les coûts fixes de développement et d’infrastructure couverts, la croissance potentielle n’est presque plus limitée que par la taille de marché et l’adaptation à ses disparités régionales, culturelles ou réglementaires » (p 125).
Déviances
Gilles Babinet consacre ensuite un chapitre à ce qu’il appelle le « Far West » de la donnée. « L’inconvénient majeur de ces stratégies en plateforme, c’est qu’elles ont tendance à prendre l’utilisateur en otage dès qu’elles atteignent un certain niveau de développement » (p 127). La critique est sévère. « Non seulement l’utilisateur n’a accès qu’à une compréhension très partielle de la manière dont ses données sont traitées, mais, de surcroit, plus la plateforme est dans une situation de domination, plus cette relation est déséquilibrée et plus le changement de destination des données est franchi avec aisance » (p 129).
Gilles Babinet poursuit sa critique des déviances d’internet en décrivant les manipulations auxquelles il se prête dans certains réseaux. A cet égard, les infiltrations russes dans les dernières élections présidentielles américaines sont bien connues. « De l’avis de l’ensemble des experts en désinformation, l’efficacité de ces outils est remarquable pour propager de fausses nouvelles, ou plus simplement orienter l’opinion des individus, instiller le doute à l’égard de l’action de leurs gouvernements, ou encore antagoniser les opinions contraires » (p 134). L’auteur nous fait part d’un exemple de propagation d’idées mensongères et dangereuses : « Un auteur anonyme Q a commencé à poster en octobre 2007 des messages sur le forum anonyme américain 4chan. Qanon évoquait l’existence d’un complot satanique et pédophile impliquant nombre de personnalités américaines. Idées conspirationnistes qui se sont répandues comme une trainée de poudre, largement relayées par les idées d’extrême droite ainsi que par des affidés russes. Au bout de quelques mois, des millions de personnes suivaient, commentaient et repostaient des contenus liés à Q. A l’apogée du phénomène Q, selon un sondage, 15% des américains estimaient que les leviers du pouvoir étaient contrôlés par une cabale d’adorateurs de Satan pédophiles. Cette hystérie de masse a eu des conséquences tragiques. Culminant dans l’assaut du Capitole, le mouvement s’est effondré ensuite… » (p 134-135).
Cependant, les objectifs que se proposent les réseaux sociaux sont généralement positifs. Pour une bonne part, les problèmes résultent d’un modèle d’affaires. « Comme l’observe le cyberactiviste Tristan Harris, c’est le modèle d’affaires même de ces plateformes qui est en cause cherchant à créer l’addiction en n’hésitant pas pour ce faire à mettre en avant les contenus les plus polémiques, de sorte à accroitre l’opportunité de vendre de la publicité ». « Seul un modèle d’affaires, qui ne reposerait pas sur la publicité, mais bien sur un abonnement payant pourrait permettre de dépasser la captation de l’attention » (p 137).
Dans un usage intensif des réseaux sociaux, on peut également redouter une diminution de notre « capacité de concentration ». Notre cerveau pourrait « être pris en otage » (p 141). Gilles Babinet conclut ce chapitre par une citation de Frances Haugen : « Les réseaux sociaux n’ont certainement pas inventé la désinformation, ni la violence, mais ils sont conçus de telle sorte qu’ils donnent à l’un et à l’autre une puissance disproportionnée, et cela ne devrait être possible en aucun cas, de façon industrielle, dans une société saine » (p 144).
Un inventaire critique
Si la désindustrialisation occidentale a entrainé un appauvrissement des classes populaires, Gilles Babinet décrit un autre phénomène au sein même de la société numérique : « le retour des privilèges et des privilégiés ». « A maints égards, l’économie numérique s’est structurée en une trentaine d’années dans un système de répartition de classes qui reproduit avec un précision effrayante l’organisation sociale de l’Ancien Régime. En haut se trouvent les nobles : Ce sont ceux qui ont fondé l’entreprise, ou ceux qui occupent les fonctions de management qui leur permettent d’accéder au capital – ceux qui, dans l’ancienne noblesse, auraient détenu la propriété de la terre, source de richesse à l’époque. Ce sont ceux qui peuvent espérer un jour gagner des montants qui se chiffrent parfois en millions de dollars… c’est une petite caste, au mieux une centaine de milliers de personnes aux Etats-Unis… Juste en dessous, se trouvent les bourgeois. Ce sont les codeurs. Ils sont remarquablement bien payés et ils bénéficient de toutes sortes d’avantages. En dessous, se trouvent les serfs : alors qu’on pensait que les travaux de labeur disparaitraient avec l’émergence de la société de connaissance, 1,3 millions de personnes sont employées par Amazon à préparer les commandes de façon répétitive et environ, 1,5 millions sont livreurs ou chauffeurs de véhicule de type Uber. Plus impressionnant encore : 55 millions d’américains, soit un tiers des actifs, ont travaillé sur des plateformes numériques, soit pour arrondir leur fin de mois, soit pour disposer d’un revenu principal ».Toute une série de plateformes « n’existeraient probablement pas si le Numérique n’avaient pas créé de nouvelles formes de travailleurs, presque jamais syndiqués, faiblement payés et dont le mode d’activité revisite radicalement le contrat social préexistant » (p 152). Les revenus sont bas, la mobilité sociale très faible. L’auteur évoque ensuit un « clergé technologique » qui garderait le dogme dans les Gafam.
« Dans les grandes villes où ces grandes firmes sont installées, les différences de revenus entre les travailleurs du numérique et les autre sont si importantes qu’elles redessinent le contexte social et urbain » (p 153) Et, de plus, toujours aux Etats-Unis « la puissance d’influence de ces entreprises technologiques trouve difficilement à quoi se comparer » (p 155). Elles gagnent notamment d’importantes exonérations fiscales.
La critique est donc sévère. « La question que nombre d’observateurs se posent désormais est de savoir si cette technologie, dont les effets s’expriment de manière omnidisciplinaire, peut encore être orientée, si son esprit propre peut être contrôlé de façon à ce que ses effets n’aient pas trop de conséquences négatives sur les sociétés contemporaines » (p 161).
Le paysage de ces dernières années est assez sombre. Gilles Babinet nous décrit ainsi des tendances « néoréactionnaires ». Il évoque un courant de pensée opérant une synthèse entre « l’héritage de la révolution technologique et celui de la révolution conservatrice ». Ces « libertariens néoréctionnaires » se disent « viscéralement attachés à la notion de liberté individuelle ». Ils s’opposent à l’intervention de l’état dans le domaine social. Ils sont opposés au principe même de la diversité » (p 172-173). Et par ailleurs, on observe des orientations transhumanistes (p 170). Le mouvement de pensée, issu de la révolution conservatrice intervenue dans les années 1990, « a réussi à imposer à tout le monde, acteurs progressistes compris, un cadre de pensée devant être nécessairement celui de l’individu. Or les technologies numériques se plient remarquablement à ce nouveau cadre… La responsabilité de cette dynamique incrimine aussi la nouvelle gauche et son incapacité à recréer une nouvelle utopie, un message politique dans lequel différentes classes sociales pourraient se retrouver et qui se serait traduit par une nouvelle forme de société inclusive. Si le combat pour une société moins inégalitaire était justifiée, ne s’est-il pas fait leurrer en acceptant de croire que l’accès à une société de consommation serait l’un des marqueurs de son succès ? Or cette consommation de produits de plus en plus virtuels, de plus en plus importés, est aussi porteuse de fragmentation sociale, d’aliénation de la capacité de revendication politique de cette classe d’acteurs » (p 171).
La puissance des plateformes est telle que le paysage international en est affecté. « Désormais, au sein d’un monde multipolaire, où les états sont camisolés dans leurs frontières, les méta-plateformes, jouant avec maestria des réalités entre les nations, avec leurs différences identitaires, exercent une réelle forme de souveraineté… » (p183). Leurs dirigeants sont reçus avec de grands égards par les chefs d’état. Leur activité de lobbying est soutenue à toute échelle. Elles exercent puissamment leurs activités dans des domaines de plus en plus nombreux. Certes les états ne sont pas voués à disparaitre, mais « ils ne sont plus systématiquement à l’initiative des enjeux de régulation de l’espace public » (p 187).
A la recherche d’une nouvelle dynamique
« Nos systèmes hérités de l’ère industrielle sont désormais en partie dysfonctionnels… Les conséquences en sont incalculables. Nous ne tirons pas tout le bénéfice possible de ces techniques… mais finalement l’essor initial qui aurait pu être orienté vers le bien commun se perd en large partie et commet même parfois des catastrophes » (p 195). Il y a donc matière à la recherche d’une nouvelle organisation collective (p 202).
A plusieurs reprises, Gilles Babinet a mis l’accent sur l’importance de l’imaginaire collectif à la source des transformations technologiques. « Au départ, nous rêvons, nous rêvons de machines, nous les pensons, puis nous les construisons… » (p 14).
« Bruno Latour, un des plus grands penseurs de l’écologie… insiste à maintes reprises sur le fait que si l’imaginaire collectif n’est pas reconquis, il est presque impossible d’établir un cadre effectif. C’est d’ailleurs précisément tout ce que nous observons au long de ce livre : Ce qui vaut pour les technologies de l’informations vaut également pour l’environnement. Par conséquent, pour faire face à des enjeux de haute complexité, l’émergence d’un imaginaire collectif semble indispensable. La caractéristique commune au monde numérique et aux enjeux d’environnement se situe largement dans leurs complexités respectives, leur transversalité : systèmes numériques comme systèmes environnementaux nécessitent une approche transversale pour être efficaces » (p 218). « Pour que les usages évoluent, il faudra nécessairement que les psychés collectives se développent autour d’autres imaginaires » (p 220).
Gilles Babinet rappelle le bouillonnement culturel qui a accompagné l’invention d’internet dans la culture californienne. « Le projet que ses membres portaient était tout à la fois communautaire, écologiste, scientifique, et au-delà, spiritualiste » (p 221). Certes, on observe aujourd’hui une plus grande défiance vis-à-vis de la technologie et des sciences. Mais le contexte général de crise pourrait engendre un dépassement et « aboutir à une nouvelle action collective ». « Bruno Latour parlait de prolétariat écologique : un prolétariat global, donc, rassemblé par Internet. La fragmentation pourrait demeurer à l’égard de thèmes épars, mais qui pourraient tout aussi bien se rassembler sur le fond, facilitant la cohabitation entre plusieurs formes de collectifs. Les technologies numériques pourraient servir alors de puissants outils d’expression politique et, peut-être également, de passage à l’action. Elles sont à la fois des moyens de mobilisation et des moyens redoutables pour engager cette transformation » (p 222). Quelque soient les embuches intervenues durant le dernière période, Gilles Babinet s’interroge sur l’avenir à partir du potentiel des origines. « Serait-il osé d’affirmer qu’il existe une forme de convergence de quelques facteurs clé, cinquante ans après l’invention d’internet ? Car désormais, non seulement les technologies numériques permettent de faire collaborer des individus à une échelle jamais imaginée, mais celles-ci ouvrent des perspectives inégalées en terme d’échange de valeurs, par exemple des dispositifs de compensation du CO2 qui pourront s’effectuer en confiance et à très large échelle… Mais, pour que ces technologies soient mises en œuvre à large échelle… Il faudra nécessairement de nouveaux archétypes collectifs. » (p 226). Pour innover, il faut savoir aller parfois à l’encontre d’habitudes mentales. L’auteur emploie le mot ‘transgression’. « Si la révolution numérique a été en large partie dévoyée par les idéologies du moment, le mercantilisme, la globalisation, l’individualisme comme fin en soi, l’invention en tant que telle d’internet n’a été rien de moins qu’une gigantesque transgression. Le fait d’imaginer que des paquets de données pouvaient circuler de façon libre » (p 227).
Aujourd’hui, la contrainte climatique nous impose un effort collectif sans équivalent, faute de quoi l’humanité pourrait rapidement être confrontée à un défi existentiel… La technologie numérique aiguillonnée par la contrainte environnementale, devrait naturellement se polariser comme elle l’a toujours fait par le passé et induire de nouvelles formes d’organisations sociales, de nouveaux modes de collaboration » (p 227).
Pour une voie nouvelle
Ce livre est intitulé : « Comment les Hippies, Dieu et la Science ont inventé internet ». En fait, remarquablement informé, il nous entraine bien au delà de l’invention d’internet, dans ses premiers pas, puis dans son expansion. Cette expansion a des visages multiples. Comme l’auteur l’avait exprimé dans un livre, il y a dix ans, « L’ère numérique » ( 3), elle ouvre un immense potentiel, mais cette expansion, dans les conditions sociales et économiques actuelles, est chargée de maux et de menaces. Dans cet ouvrage, Gilles Babinet met en évidence « un dévoiement par les idéologies du moment ; le mercantilisme, la globalisation, l’individualisme comme fin en soi ». C’est là qu’il est important de remonter aux origines et d’en rappeler l’esprit. En ce temps là, une écologie précocement affirmée est associée à la technologie montante, un élan communautaire avec un principe de liberté. Cet idéal était inspiré par une « harmonie supérieure ». Certes, cette histoire était californienne, mais elle portait un universalisme toujours actuel.
Comme le répète Gilles Babinet, l’expansion des technologies dépend de la manière dont nous voyons le monde, autant que celles-ci influent ensuite sur cette manière. La conjoncture intervient. Aujourd’hui, la vision écologique s’amplifie dans la conscience du déclin de la biodiversité et la menace pressante du dérèglement climatique. Cette vision s’accorde avec une manière nouvelle d’envisager l’humanité dans une perspective relationnelle. Ecologie et internet peuvent être envisagés dans cette même perspective. Ici, nous retrouvons l’inspiration des origines : « La foi en une harmonie supérieure ».
Jean Hassenforder
(1) Gilles Babinet. Comment les Hippies, Dieu et la Science ont inventé Internet. Odile Jacob, 2023
