 Etre un homme.
Etre un homme.
L’auteur de L’Homme révolté a su rejoindre les interrogations et l’incroyance des masses. Le 50e anniversaire de sa disparition est l’occasion de mieux connaître sa pensée et sa démarche autant philosophique qu’existentielle. Arnaud Corbic s’y attelle avec brio et compétence (Camus et l’homme sans Dieu, Cerf, 2007). Son étude consacrée à la confrontation entre Camus et le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, Camus et Bonhoeffer, rencontre de deux humanismes (Labor et Fides, 2002) met en dialogue les pensées de ces deux auteurs qu’a priori tout semble éloigner, et nous permet de confronter la foi chrétienne à une incroyance qui demande à être mieux sondée.
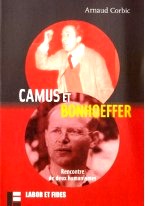 Pourquoi Camus connaît-il une popularité certaine chez les jeunes ?
Pourquoi Camus connaît-il une popularité certaine chez les jeunes ?
En tant qu’enseignant en philosophie, je constate effectivement que les élèves sont très sensibles à l’approche de Camus sur un certain nombre de questions : les thèmes de l’absurde ou de la révolte ne sont pas étrangers à leurs propres préoccupations. On doit cette popularité aux problèmes que Camus a eu le mérite de poser dans toute leur lumière et crudité. Il est incontestablement un penseur ce que d’ailleurs Paul Ricoeur rappelait à la suite de la parution de L’Homme révolté parce qu’il nous met en face de problèmes cruciaux : le problème du Mal et de la révolte, les impasses du nihilisme et la question de l’absurde dont on ne peut faire l’économie, aujourd’hui, dans une société postchrétienne. Il s’exprime dans une langue très accessible. N’oublions pas qu’il est d’abord écrivain avant que d’être philosophe c’est ce que disait Jean Grenier, son maître.
D’une brève biographie, qu’est-ce qui ressort du personnage ?
Rappelons qu’il est pied-noir, né en Algérie en 1913, à Mondovi dans le département de Constantine (aujourd’hui Drean). Une clé de lecture de l’ensemble de son œuvre se réfère à l’amour déjà chanté avec fougue par le jeune Camus dans Noces : expérience d’harmonie, d’accord profond avec le monde compris comme cosmos. C’est ce qui lui a permis de dépasser l’expérience de l’absurde. Il l’écrit d’ailleurs : « L’absurde est un point de départ et non pas un point d’arrivée ». Camus avait conçu son œuvre selon un plan précis : l’absurde, la révolte, l’amour. Cette notion d’amour, on n’a guère pu la voir apparaître du fait de sa mort brutale dans un accident de voiture le 4 janvier 1960. On a découvert dans sa sacoche le manuscrit de ce qui devait devenir son roman quasi autobiographique Le Premier Homme, œuvre inachevée où l’on trouve déjà développé ce thème de l’amour. Certaines nouvelles de L’Été ou de L’Exil et le  Royaume, mais aussi La Chute, équivalent du doute méthodique mais en morale, vont préparer ce troisième acte-axe consacré au thème de l’amour. Camus s’inscrit dans la tradition des grands moralistes français, La Rochefoucauld, Chamfort auquel il a consacré de très belles pages, ou Pascal qui montrait qu’il faut bien distinguer ce qui est de l’ordre de l’amour proprement dit de l’amour-propre, Camus dénonçant cet empire universel de l’amour-propre.
Royaume, mais aussi La Chute, équivalent du doute méthodique mais en morale, vont préparer ce troisième acte-axe consacré au thème de l’amour. Camus s’inscrit dans la tradition des grands moralistes français, La Rochefoucauld, Chamfort auquel il a consacré de très belles pages, ou Pascal qui montrait qu’il faut bien distinguer ce qui est de l’ordre de l’amour proprement dit de l’amour-propre, Camus dénonçant cet empire universel de l’amour-propre.
Son rapport à la religion ?
Ses parents étaient de tradition catholique, il a reçu le baptême un an après sa naissance, et il a rencontré dans son enfance un christianisme emprunt de superstition. On le voit notamment à travers l’évocation d’une vieille femme dans L’Envers et l’Endroit : « Cette petite vieille, remuante et bavarde, réduite au silence et à l’immobilité. Sa vie entière se ramenait à Dieu, écrit-il. Elle croyait en Lui. Et la preuve est qu’elle avait un chapelet, un Christ de plomb et en stuc un Saint-Joseph portant l’Enfant. » Et dans une variante de ce texte, Camus avait écrit : « Sa vie larvaire ne donnait que sur une fenêtre : Dieu ». Fausse fenêtre pensait déjà le jeune Camus alors bouillonnant d’appétit sensuel. Il faut bien voir qu’il a vraiment eu de décevantes images de la superstition religieuse dès son enfance. Elles l’ont conduit à s’éloigner définitivement du christianisme. Mais il va l e retrouver à travers la figure de Saint Augustin de Thagaste, né à trente kilomètres à peine de son propre lieu de naissance. Camus a toujours vu en Saint Augustin un frère méditerranéen dont il disait se sentir proche. Il se comparait évidemment à l’Augustin d’avant la conversion au christianisme : celui qui a regardé en face le problème du mal, l’homme qui aimait aussi la vie dans ses manifestations sensibles. Mais il sera conduit aussi à répondre à des siècles de distance à Saint Augustin : la révolte qu’il va mettre en lumière est aux antipodes de la soumission à la grâce que l’on retrouvera chez Saint Augustin. Mais aussi chez Pascal qui va beaucoup marquer Camus. Il écrivait dans ses Carnets : « Je suis de ceux que Pascal bouleverse et ne convertit pas. Pascal, le plus grand de tous, hier et aujourd’hui ». Admiration et en même temps critique par rapport à ces deux grandes figures du christianisme.
e retrouver à travers la figure de Saint Augustin de Thagaste, né à trente kilomètres à peine de son propre lieu de naissance. Camus a toujours vu en Saint Augustin un frère méditerranéen dont il disait se sentir proche. Il se comparait évidemment à l’Augustin d’avant la conversion au christianisme : celui qui a regardé en face le problème du mal, l’homme qui aimait aussi la vie dans ses manifestations sensibles. Mais il sera conduit aussi à répondre à des siècles de distance à Saint Augustin : la révolte qu’il va mettre en lumière est aux antipodes de la soumission à la grâce que l’on retrouvera chez Saint Augustin. Mais aussi chez Pascal qui va beaucoup marquer Camus. Il écrivait dans ses Carnets : « Je suis de ceux que Pascal bouleverse et ne convertit pas. Pascal, le plus grand de tous, hier et aujourd’hui ». Admiration et en même temps critique par rapport à ces deux grandes figures du christianisme.  On pourrait y ajouter la figure de François d’Assise. La raison pour laquelle il admirait le Poverello était qu’il avait su créer un hymne à la nature et à la joie naïve, une exaltation de la nature à laquelle Camus était très sensible, puisque dans les pages de Noces baignées de soleil et de sel, on retrouve cette exaltation de la nature. Mais il faut bien voir que ce sont dans des perspectives extrêmement différentes. Camus n’aime François d’Assise, Saint Augustin et Pascal que dans une perspective non religieuse.
On pourrait y ajouter la figure de François d’Assise. La raison pour laquelle il admirait le Poverello était qu’il avait su créer un hymne à la nature et à la joie naïve, une exaltation de la nature à laquelle Camus était très sensible, puisque dans les pages de Noces baignées de soleil et de sel, on retrouve cette exaltation de la nature. Mais il faut bien voir que ce sont dans des perspectives extrêmement différentes. Camus n’aime François d’Assise, Saint Augustin et Pascal que dans une perspective non religieuse.
Athée ?
Non, pas à proprement parler. Il est d’abord agnostique en conscience. C’est-à-dire qu’il juge indécidable la question de l’existence de Dieu. Mais parce qu’il sait que la question de Dieu ne peut rester en suspens, dans l’action, dans la pratique, il estime qu’il faut bien vivre comme si Dieu existait ou n’existait pas. Autrement dit, il reprend la perspective du pari pascalien, mais non pas du tout dans son dessein apologétique et pour cause ! mais pour parier contre l’existence de Dieu. Cela ne veut pas dire qu’il soit athée au sens où il nierait l’existence de Dieu car cela reviendrait à affirmer quelque chose d’indémontrable, et Camus, de ce point de vue, reste agnostique.
Il pose donc l’hypothèse que Dieu n’existe pas ?
Exactement ! On peut dire qu’il est incroyant, mais d’une incroyance conséquente et décidée. Il préférait d’ailleurs se dire incroyant. J’aimerais le citer dans la mesure où on a beaucoup glosé en se trompant à son sujet. Voici ce qu’il dit chez les dominicains, en 1948, lors d’une conférence qui s’intitule L’Incroyant et les Chrétiens : « Ne me sentant en possession d’aucune vérité absolue et d’aucun message, je ne partirai jamais du principe que la vérité chrétienne est illusoire mais seulement de ce fait que je n’ai pu y entrer ». Il est clair qu’il y a là une position agnostique. Il ne s’agit pas de nier l’existence de Dieu, mais il reconnaît ne pas avoir fait cette expérience.
Il n’est pas en opposition. Il y a une espèce de déception : Camus, déçu de Dieu ?
Oui, c’est très juste. D’ailleurs sa définition même de l’absurde comme ce qui naît de la « confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde » indique bien qu’il y a quand même une sorte de déception. Puisque le monde est pensé comme devant avoir un sens a priori. Or, c’est tout à fait discutable. Quelqu’un comme Sartre, qui est athée originairement, dira : il n’y a pas besoin d’enregistrer l’absence de Dieu et du monde pour pouvoir donner un sens à l’existence. Selon Sartre, c’est à « l’homme créateur de valeurs et donateur de sens par sa liberté » que revient l’injection de sens dans un monde qui est neutre dès le départ. Donc le monde n’est pas pensé comme devant avoir un sens par avance. Tandis que chez Camus il y a quand même cette idée que puisqu’il y a « un silence déraisonnable du monde » celui-ci est pensé comme devant avoir un sens a priori. N’oublions pas que Camus avait pensé à sous-titrer Le Malentendu : « Dieu ne répond pas » ! Ce qui montre bien que Dieu est présent comme absent. Dieu, ce grand absent-présent, est présent dans son absence même. Le véritable athée est celui pour qui la question de Dieu ne se pose pas ou ne se pose plus. C’est le cas de Sartre par exemple. Chez Camus, rien de tel. Je le cite encore dans ses Carnets : « Je lis souvent que je suis athée. J’entends parler de mon athéisme. Or ces mots ne me disent rien. Ils n’ont pas de sens pour moi. Je ne crois pas à Dieu et je ne suis pas athée ». Dans Le Mythe de Sisyphe, Camus souligne qu’il n’argumente pas contre l’existence de Dieu, mais le fait demeure qu’il ne croit pas en Dieu. En résumé on peut dire que pour lui ni la raison, ni l’expérience ne permettant de trancher la question, c’est finalement l’agnosticisme qui lui paraît la voie la plus cohérente, et celle-là même de l’honnêteté intellectuelle. Tout au long de sa vie et de son œuvre, l’incroyance ne cesse d’être une question pour lui. Il semble qu’il y ait même chez lui une sorte d’ambivalence que trahissent parfois la passion même et l’âpreté clairvoyante de ses critiques à l’égard du christianisme et de l’Eglise.
D’un certain christianisme ?
Oui, vous faites bien de le préciser, passion et critique qui se comprennent d’ailleurs sur fond de son admiration réitérée pour la personne du Christ comme il l’a lui-même rappelé à Stockholm en 1957 : « Je n’ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. » Il est sensible à l’humanité profonde du Christ, mais il ne peut pour sa part reconnaître sa divinité. Camus a maintenu l’exigence d’un dialogue critique et fécond, lucide, avec le christianisme tel qu’il a été vécu par son fondateur, Jésus, le galiléen, mais aussi par quelques grandes figures : Saint Augustin, François d’Assise, Pascal et aussi quelques chrétiens de son temps engagés dans la Résistance.
Dieu ?
Camus a tendance à voir Dieu comme tout-puissant et comme responsable du mal qui existe dans le monde. C’est ce qu’on perçoit dans  La Peste à propos de l’agonie du fils du juge Othon. Camus est très proche de Dostoïevski avec ses personnages autour de la souffrance des enfants. C’est le paradoxe d’un Dieu tout-puissant et malfaisant ou bienfaisant et stérile. Il écrit dans Le Mythe de Sisyphe : « Ou nous ne sommes pas libres, et Dieu tout-puissant est responsable du mal. Ou nous sommes libres et responsables, mais Dieu n’est pas tout-puissant. » C’est régi par une logique du tout ou rien qui évidemment appelle bien des réserves. Car on ne peut pas dire qu’il y a dans la foi chrétienne une conception univoque de la toute-puissance de Dieu. D’abord parce que dans le Credo on confesse bien le Père tout-puissant en tant que créateur et en tant qu’il ressuscite le Fils, mais dans le même Symbole des apôtres on dit aussi que le Christ a souffert et qu’il est mort. Cela veut dire qu’on ne peut pas parler de la Trinité uniquement en terme de toute-puissance, il y a aussi de la vulnérabilité en Dieu. Je pense aux pages de Moltmann sur la mort en Dieu (pas la mort de Dieu) qui permettent de relativiser un certain nombre de remarques de Camus qui considère un Dieu impassible, telle que la théologie classique ou les theopashites l’ont dépeint. Le problème vient de sa conception binaire : ou Dieu ou l’homme. Alors qu’en christianisme on ne peut pas opposer Dieu à l’homme, ou choisir l’un et abandonner l’autre, puisque Dieu s’est révélé pleinement en un homme avec et pour l’homme jusqu’à donner son Fils. Camus est tributaire de ce préjugé, faute d’une connaissance intime de la Révélation chrétienne. Mais il ne faut pas non plus lui jeter la pierre, loin de là, car il y a tout ce qu’un certain christianisme et ses contresens lui ont donné à voir.
La Peste à propos de l’agonie du fils du juge Othon. Camus est très proche de Dostoïevski avec ses personnages autour de la souffrance des enfants. C’est le paradoxe d’un Dieu tout-puissant et malfaisant ou bienfaisant et stérile. Il écrit dans Le Mythe de Sisyphe : « Ou nous ne sommes pas libres, et Dieu tout-puissant est responsable du mal. Ou nous sommes libres et responsables, mais Dieu n’est pas tout-puissant. » C’est régi par une logique du tout ou rien qui évidemment appelle bien des réserves. Car on ne peut pas dire qu’il y a dans la foi chrétienne une conception univoque de la toute-puissance de Dieu. D’abord parce que dans le Credo on confesse bien le Père tout-puissant en tant que créateur et en tant qu’il ressuscite le Fils, mais dans le même Symbole des apôtres on dit aussi que le Christ a souffert et qu’il est mort. Cela veut dire qu’on ne peut pas parler de la Trinité uniquement en terme de toute-puissance, il y a aussi de la vulnérabilité en Dieu. Je pense aux pages de Moltmann sur la mort en Dieu (pas la mort de Dieu) qui permettent de relativiser un certain nombre de remarques de Camus qui considère un Dieu impassible, telle que la théologie classique ou les theopashites l’ont dépeint. Le problème vient de sa conception binaire : ou Dieu ou l’homme. Alors qu’en christianisme on ne peut pas opposer Dieu à l’homme, ou choisir l’un et abandonner l’autre, puisque Dieu s’est révélé pleinement en un homme avec et pour l’homme jusqu’à donner son Fils. Camus est tributaire de ce préjugé, faute d’une connaissance intime de la Révélation chrétienne. Mais il ne faut pas non plus lui jeter la pierre, loin de là, car il y a tout ce qu’un certain christianisme et ses contresens lui ont donné à voir.
L’absurde, la révolte et l’amour.
Les fondements d’une philosophie de l’homme sans Dieu chez Camus reposent sur une trilogie : L’absurde, la révolte et l’amour. Comment cela s’articule-t-il ?
C’est Camus lui-même qui a expliqué à Stockholm, en 1957, comment il avait conçu l’ensemble de son œuvre. Je le cite : « J’avais un plan précis quand j’ai commencé mon œuvre. Je voulais d’abord exprimer la négation ce terme désigne  l’absurde chez lui – sous trois formes : romanesque, ce fut « L’Etranger », dramatique « Caligula, le Malentendu », idéologique ou philosophique si vous voulez « Le Mythe de Sisyphe ». Je n’aurais pu en parler si je ne l’avais vécu. Je n’ai aucune imagination Il ne faut pas le prendre au mot, il en a beaucoup ! , mais c’était pour moi, si vous le voulez bien, le doute méthodique de Descartes. Je savais, dit-il, que l’on ne peut vivre dans la négation, c’est-à-dire dans l’absurde, et je l’annonçais dans la préface au « Mythe de Sisyphe ». Je prévoyais le positif, la révolte sous trois formes encore : Romanesque « La Peste », dramatique « L’Etat de Siège », « Les Justes », idéologique « L’Homme révolté ». J’entrevoyais, dit-il, déjà une troisième couche autour du thème de l’amour. Ce sont les projets que j’ai en train ». Puis trois ans plus tard, il était tué dans un accident de voiture. L’œuvre de Camus jette les fondements d’une sagesse de vie pour l’homme sans Dieu selon une triple perspective : une manière de concevoir le monde sans Dieu l’absurde , une manière d’exister la révolte et une manière de se comporter l’amour, une éthique de l’amour.
l’absurde chez lui – sous trois formes : romanesque, ce fut « L’Etranger », dramatique « Caligula, le Malentendu », idéologique ou philosophique si vous voulez « Le Mythe de Sisyphe ». Je n’aurais pu en parler si je ne l’avais vécu. Je n’ai aucune imagination Il ne faut pas le prendre au mot, il en a beaucoup ! , mais c’était pour moi, si vous le voulez bien, le doute méthodique de Descartes. Je savais, dit-il, que l’on ne peut vivre dans la négation, c’est-à-dire dans l’absurde, et je l’annonçais dans la préface au « Mythe de Sisyphe ». Je prévoyais le positif, la révolte sous trois formes encore : Romanesque « La Peste », dramatique « L’Etat de Siège », « Les Justes », idéologique « L’Homme révolté ». J’entrevoyais, dit-il, déjà une troisième couche autour du thème de l’amour. Ce sont les projets que j’ai en train ». Puis trois ans plus tard, il était tué dans un accident de voiture. L’œuvre de Camus jette les fondements d’une sagesse de vie pour l’homme sans Dieu selon une triple perspective : une manière de concevoir le monde sans Dieu l’absurde , une manière d’exister la révolte et une manière de se comporter l’amour, une éthique de l’amour.
L’absurde ?
L’absurde est d’abord pour Camus un commencement obligé, une donnée à partir de laquelle on peut et on doit construire. Mais on ne peut rien fonder sur sa seule découverte. L’absurde, chez Camus, naît de la « confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde. Dans un univers soudain privé d’illusion et de lumières l’homme se sent un étranger. Ce divorce entre l’homme et sa vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le sentiment de l’absurdité, écrit Camus. »
Donc c’est un constat, un état de fait.
Absolument, c’est une expérience. Le sentiment d’un divorce entre l’homme et le monde, alors même que dans Noces le jeune Camus célébrait avec fougue ses noces avec la terre. Mais si l’absurde est un commencement, l’amour est à l’origine. Il lui est antérieur, au sens non pas chronologique mais archaïque du terme grec archè. L’amour est à l’origine, l’absurde est un commencement. Cet amour qui enveloppe le non de la révolte.
Ce qui rend positif la démarche et aboutit à une espèce de sérénité, à un contentement ?
Absolument ! Ce qu’il faut bien voir c’est que la révolte en elle-même peut déboucher sur ce que Camus appelle le nihilisme, c’est-à-dire la haine de la vie au nom de l’absurde. Or, pour que cette révolte ne débouche pas sur la négation, sur la haine de la vie au nom de l’absurde, il faut que le « non » de la révolte soit équilibré par le « oui » de amour. Je cite Camus, dans les dernières pages de L’Homme révolté : « La révolte ne peut se passer d’un étrange amour. » La révolte féconde, la révolte généreuse.
On le sent quand même en tension ?
Bien sûr ! Pour Camus, l’homme se doit de faire face à l’absurde parce que c’est précisément dans la reconnaissance de l’absurde comme tel que l’homme va trouver sa grandeur et affirmer la dignité de la révolte. Pour que la révolte émerge, il faut que je reconnaisse l’absurde comme tel ; sinon, dit Camus, « je vais fuir dans l’espoir ». Et il va d’ailleurs disqualifier l’existentialisme chrétien qu’il juge infidèle à la révolte que l’homme se doit à lui-même, car celui-ci transforme l’absurde en « tremplin d’éternité ». C’est ce qu’il critique sous l’expression de « suicide philosophique ». Sa critique des philosophes existentiels, Kierkegaard, Jaspers, etc. reste quand même très discutable d’un point de vue philosophique. Hélène Politis, spécialiste de Kierkegaard, l’a très bien montré dans certains de ses ouvrages.
L’absurde est une expérience individuelle, personnelle, la révolte a une dimension collective, solidaire, c’est ça ?
Oui, tout à fait ! On est dans révolte encore solitaire dans Le Mythe de Sisyphe, puisque Sisyphe est seul à pousser son rocher jusqu’au sommet d’une montagne du haut de laquelle celui-ci retombe sans cesse.
Camus réécrit le mythe, enfin il en donne une autre finale…
Oui, il le revisite et le vivifie : « il faut imaginer Sisyphe heureux ». C’est un paradoxe. L’essai commence par le suicide : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux c’est le suicide ». Et il aboutit à un pessimisme actif, puisqu’il faut imaginer Sisyphe heureux. Et la révolte encore solitaire du Mythe de Sisyphe va devenir une valeur positive commune dans L’Homme révolté où l’on assiste à ce passage de la révolte solitaire contre l’absurde à la révolte solidaire. On retrouve ce jeu de mot dans l’une des nouvelles de L’Exil et le Royaume, intitulée Jonas ou l’Artiste au travail. Camus met en évidence un nouveau cogito, « je me révolte donc nous sommes », principe fondateur de la nature humaine, et qui justifie la solidarité.
Un saint laïc ?
Non ! Cet idéal de sainteté laïque, à savoir « être un saint sans Dieu », selon la formule célèbre tirée de La Peste, que d’aucuns ont parfois attribué à tort à Camus et que celui-ci prête à l’un de ses personnages, Tarrou, n’est nullement celui de l’écrivain. N’en déplaise à ceux qui ont mal lu La Peste et qui se sont empressés de « canoniser » son auteur sous le nom de « saint laïque ». Ce qui intéresse Camus dont le docteur Rieux est le porte-parole, c’est bien d’être un homme. Et à travers la figure emblématique du médecin, un homme solidaire. En second lieu, on peut dire que cet idéal de sainteté sans Dieu est dans sa formulation même non seulement anti-augustinien et anti-pascalien c’est ce que montre d’ailleurs très bien Maurice Weyembergh, vice-président de la société des études camusiennes , mais aussi hyperpélagien puisque Dieu et la grâce n’ont plus rien à voir avec un projet qui reprend pourtant l’idéal chrétien qui est la sainteté. Maintenant la question qu’on peut se poser est la suivante : cette opposition saint/laïc et la critique du christianisme que sous-tend La Peste sont-elles valables et pertinentes au regard de la foi en la Révélation ? D’abord, au regard de l’histoire il n’est pas certain que l’on puisse assimiler aussi simplement les saints à la figure de héros, comme le pense Camus. Beaucoup d’entre eux ont plutôt été de leur vivant du côté des vaincus et des martyrs, ne cherchant pas un idéal de sainteté personnelle ou d’héroïsme vertueux, mais partageant une solidarité avec les vaincus. La question essentielle n’est pas là. Il s’agit plutôt de savoir si, au regard de la foi en la Révélation, celle-ci permet à l’homme d’assumer son humanité en étant un homme avec et pour les autres. Et c’est finalement la question que Camus pose ici indirectement au christianisme dans un monde sans Dieu, et ce que Dietrich Bonhoeffer fait également, mais dans une perspective chrétienne.
 CAMUS et BONHOEFFER
CAMUS et BONHOEFFER
Pourquoi d’abord cet intérêt pour ce pasteur théologien protestant ?
Bonhoeffer a su rejoindre ces non-religieux avec lesquels l’Eglise a aujourd’hui tant de peine à communiquer. Un confrère franciscain, qui fut mon professeur durant mes études de théologie, Yves Tourenne, avait fait une présentation de la vie de Bonhoeffer et il nous avait familiarisé avec quelques-uns de ses textes, notamment ses lettres de prison(1). C’est à cette époque que j’ai pu m’en approcher, et cela a suffi pour que je désire aller à la découverte de la vie et de la pensée de Dietrich Bonhoeffer. J’en ai donc fait un sujet d’étude universitaire. Ce qui m’a profondément interpellé, c’est qu’il prend vraiment en compte les questions de l’athéisme pratique, tout en préservant une foi très vive et profonde. On sent chez lui une grande santé(2) spirituelle, une capacité à se laisser toucher par la réalité. Mais c’est au regard de la foi en la Révélation qu’il la prend au sérieux. Il a su témoigner de sa foi jusqu’au péril de sa vie. C’est alors que j’ai écrit Dietrich Bonhoeffer, résistant et prophète d’un christianisme non religieux (Albin Michel).
Il n’était donc pas qu’un résistant politique ?
Non, on aurait tort de le réduire à cela. J’ai justement essayé de le resituer dans le contexte de toute sa vie. Il a d’abord été amené à être un résistant spirituel au nazisme, dans le contexte de l’Eglise confessante (entre autres avec Karl Barth et Martin Niemöller), quand il était animateur du séminaire de Finkenwalde. Il fut l’un des premiers à discerner la perversion de Hitler, tant au plan politique qu’au plan théologique. Il en est sorti deux ouvrages importants. Le Prix de la grâce et De la vie communautaire sont nés de cette expérience-là. Et avec L’Ethique Bonhoeffer s’est pleinement engagé dans la résistance politique jusqu’à ce qu’il soit arrêté (3). Ce qui m’a vraiment donné envie d’aller plus loin dans la découverte de cet homme, c’est une unité profonde entre la pensée et l’agir. On sent que cet équilibre se cherche et se trouve grâce à son sens profond de l’homme et à une foi en Dieu bien ancrée dans la réalité.
Pourquoi le parallèle avec Camus ?
Il m’a semblé pertinent de dresser ce parallèle parce que, tout d’abord, Bonhoeffer et Camus sont des contemporains. Bonhoeffer est né en 1906 (4), Camus en 1913. C’est déjà important à signaler, car on voit qu’ils évoluent dans une réalité similaire, celle de la seconde guerre mondiale. Plus important encore : l’un et l’autre se sont engagés dans la résistance active, Camus au sein du réseau Combat et du journal du même nom, et Bonhoeffer au sein même de l’Eglise confessante(5), puis au sein de la résistance politique – rappelons qu’il fut pendu par les nazis en 1945. Ce contexte de résistance si singulier et cette confrontation à une réalité dans ce qu’elle a de paroxystique les ont amenés à aborder des questions existentielles très proches. Mais évidemment les éléments de réponses qu’ils apportent à certaines de ces questions les situent différemment. Ils ont en commun d’être tous deux des penseurs non religieux, mais Bonhoeffer au regard de la foi. Camus mène une critique contre le christianisme, un certain christianisme vu de l’extérieur, et Bonhoeffer une critique du christianisme mais informé par la foi en la Révélation. Leur pensée se rencontre et diverge sur plusieurs points. Il ne s’agit pas de faire de syncrétisme, c’est évident.
Les arrière-mondes
Le premier thème est celui de la fidélité à la terre contre les arrière-mondes. C’est une notion que Camus emprunte à Nietzsche qui reprochait au christianisme d’être infidèle à la terre en postulant une autre vie. C’est l’idée que les chrétiens échapperaient à la réalité parfois dure de la vie et s’inventeraient une autre vie ou un autre monde comme masque ou alibi de leurs faiblesses. On peut citer quelques phrases significatives de Noces : « Car si il y a un péché contre la vie, ce n’est peut-être pas d’en désespérer que d’espérer une autre vie et se dérober à l’implacable grandeur de celle-ci. ». Ou encore : « Si je refuse obstinément tous les plus tard du monde c’est qu’il s’agit aussi bien de ne pas renoncer à ma richesse présente. Il ne me plaît pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie. Elle est pour moi une porte fermée ».
Bonhoeffer le rejoint-il sur ce point ?
Oui, Bonhoeffer écrit dans l’une de ses lettres de captivité : « Quiconque fuit le monde […] ne trouve pas Dieu mais un autre monde à savoir son propre monde, meilleur, plus beau, plus paisible, un arrière-monde. » L’expression « arrière-monde » est utilisée par Bonhoeffer lui-même, Hinterwelt en allemand. C’est bien sûr l’expression même de Nietzsche que Camus et Bonhoeffer reprennent dans des perspectives différentes. Pour Bonhoeffer il y aurait une manière mensongère à présenter le christianisme ou à parler de Dieu comme bouche-trou et toujours comme extérieur au monde. Alors que si nous sommes chrétiens et que nous croyons en la Révélation de Dieu en un homme, Jésus, nous devons bien confesser que Dieu s’est révélé au cœur de la vie humaine. Et on ne peut plus parler de Dieu en terme de bouche-trou pour l’ignorance ou de deus ex machina pour la consolation. La foi chrétienne et le Christ lui-même nous renvoient aussi, dans l’Evangile et à travers le Sermon sur la montagne, à nos tâches d’homme. Donc il n’y a pas de fuite du monde, au contraire. Le Christ et le christianisme renvoient toujours aux réalités présentes, aux réalités avant-dernières pour reprendre l’expression même de Bonhoeffer. C’est un contresens fait sur le christianisme et par certains chrétiens que de dévaluer cette vie au profit de cette autre vie. Le terme même d’autre vie n’est pas juste d’un point de vue théologique, puisqu’on peut dire qu’il y a un « déjà là » et un « pas encore » dans l’eschatologie chrétienne. D’ailleurs le Christ ne cesse de parler du Royaume de Dieu en terme de graine semée. Il y a cette tension fondamentale entre le « déjà là » et le « pas encore ». Le Royaume de Dieu est déjà commencé (6), même s’il est encore à venir. Cela nous empêche non seulement d’idolâtrer la terre, ce que peut faire Camus peut-être (cf. Noces) ou Nietzsche (avec son idée d’éternel retour), mais également « le ciel ». Bonhoeffer nous invite à voir que Dieu, en Jésus Christ, nous renvoie toujours aux réalités banales et ordinaires de l’existence profane, la Révélation même s’y inscrit. La Bible, y compris l’Ancien Testament, parle de Dieu dans l’en deçà et pas seulement de l’au-delà. Dieu surgit dans la polyphonie de la vie. Autrement dit, on est ramené à l’Histoire. Toujours parler de Dieu de manière métaphysique, c’est-à-dire comme étant en permanence au-delà du monde, c’est avoir une conception toute religieuse et erronée de la foi chrétienne. L’évangile et la Bible, au contraire, nous montrent que Dieu est celui qui a pris corps dans le temps. Certes, il quitte le lieu de nos particularités et nous introduit au mystère de l’éternité, mais il ne faudrait pas penser l’éternité comme étant déconnecté du temps, car Dieu s’est identifié « à-ce-qui-passe » (E. Jüngel) ici-bas en Jésus Christ, et c’est désormais à prendre en compte.
Bonhoeffer écrit en captivité dans une période complètement folle, confronté au problème du Mal…
Absolument ! C’est très juste. Je le cite : « Dieu se laisse déloger du monde et clouer sur la croix. Dieu est impuissant et faible dans le monde. Et ainsi seulement il est avec nous et nous aide. Matthieu nous indique clairement que le Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance mais par sa faiblesse et ses souffrances. Voilà la différence décisive d’avec toutes les autres religions. La religiosité de l’homme, elle, renvoie dans sa misère à la puissance de Dieu dans le monde. Dieu est le deus ex machina. La Bible, elle, renvoie à la souffrance et à la faiblesse de Dieu. Seul le Dieu souffrant peut aider. En ce sens on peut dire que l’évolution du monde vers l’âge adulte dont nous avons parlé faisant table rase d’une fausse image de Dieu libère le regard de l’homme pour le diriger vers le Dieu de la Bible qui acquière sa puissance et sa place dans le monde par son impuissance. » Selon Bonhoeffer, il y a donc impuissance partielle de Dieu dans le monde, c’est l’événement de la croix, mais tout ne s’arrête pas au vendredi saint puisqu’il y a la résurrection. Il ne faut pas court-circuiter le moment de la croix mais bien tenir ensemble ces deux événements. Camus et Bonhoeffer nous invitent à prendre au sérieux la question d’un absurde avant-dernier et la question du mal dans son caractère massif. Il ne convient pas de vouloir tout de suite en faire un tremplin pour l’éternité. D’ailleurs Bonhoeffer lui-même écrivait : « Je voudrais parler de Dieu non dans la mort mais dans la vie, dans la force et la bonté de l’homme. Près des limites il me semble préférable de se taire ». Bonhoeffer ne veut pas qu’on réduise Dieu à n’être finalement qu’un bouche-trou, parce que Dieu est plus grand que cela. Dieu ne ressort pas grandi d’une apologétique qui voudrait contraindre à se tourner vers lui dans l’absurde et dans la souffrance. Il est étranger à la foi chrétienne de penser qu’il faille commencer par abaisser l’homme pour pouvoir le mettre en face de Dieu et d’admettre que Dieu soit d’autant plus honoré que l’homme est amoindri ou méprisé, ce qui reviendrait à mépriser les deux à la fois.
Bonhoeffer rejoint aussi Camus sur la question d’être un homme.
Bien sûr. Et on a l’impression qu’ils se répondent, bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés. Bonhoeffer écrit : « Je me rappelle une discussion que j’ai eue en Amérique avec un jeune pasteur français, il y a treize ans. Nous nous étions posé tout simplement cette question : que voulons-nous faire de notre vie ? Il me dit : ‘J’aimerais être un saint.’ […] je répliquai à peu près : ‘Moi, j’aimerais apprendre à croire’ […] J’ai compris plus tard et je continue d’apprendre que c’est en vivant pleinement la vie terrestre qu’on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu’un – un saint, ou un pécheur converti, ou un homme d’Eglise… afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités – et c’est cela que j’appelle vivre dans le monde, alors on se met entre les mains de Dieu, on prend au sérieux non ses propres souffrances, mais celles de Dieu dans le monde, on veille avec le Christ à Gethsémani ; telle est, je pense, la foi, la metanoia ; c’est ainsi qu’on devient un homme (7), un chrétien. »(8) Et quelques lignes plus haut, il le dit sans ambages : « Etre chrétien ne signifie pas être religieux d’une certaine manière… cela signifie être un homme. » Et non pas au sens d’un type d’homme, parce que Dieu lui-même s’est révélé absolument en un homme avec et pour les autres en Jésus Christ. C’est ici l’ancrage christologique et évangélique de Bonhoeffer. « Le chrétien n’est pas homo religiosus, mais tout simplement un homme, comme Jésus était un homme… », écrit-il encore. Contrairement à ce que pense Camus en formulant finalement une opposition nette entre « être un saint sans Dieu » et « être un homme », le croyant avec Dieu et sans Dieu ne recherche pas un modèle de sainteté personnelle ou héroïque, mais, comme le rappelle Bonhoeffer, le chrétien authentique est appelé dans un monde sans Dieu, c’est-à-dire dans un monde qui se passe de Dieu et qui ne l’invoque plus, à devenir un homme solidaire avec et pour les autres. Et de ce point de vue-là, Camus et Bonhoeffer se rejoignent. Il y aurait eu sans doute un dialogue très fécond entre les deux résistants s’ils avaient pu se rencontrer.
Entretien avec Arnaud Corbic, conduit par François Sergy
NOTES :
(1) Cf. Lettre de fiançailles – Cellule 92 1943-1945, Dietrich Bonhoeffer – Maria von Wedmeyer (Labor et Fides, 1998 avec introduction et illustrations).
(2) Selon l’expression de Nietzsche.
(3) Dietrich Bonhoeffer, résistant, a été arrêté et emprisonné le 5 avril 1943. Transféré à la prison nazie de la Prinz-Albrecht-Strasse en octobre 1944 « cœur des institutions politiques et policières de la Gestapo » , après l’attentat manqué du Führer (20 juillet 1944), on lui interdira toute visite et toute correspondance. Déporté ensuite au camp de Buchenwald, il est exécuté dans celui de Flöossenbürg en avril 1945. Dans une famille luthérienne de Breslau en Silésie (aujourd’hui Wroclaw en Pologne
(4) Dans une famille luthérienne de Breslau en Silésie (aujourd’hui Wroclaw en Pologne).
(5) A distinguer des « chrétiens allemands », inféodés au nazisme.
(6) Cf. Matthieu 3 :2.
(7) C’est nous qui soulignons.
(8) Résistance et soumission, pp.371-372 (Labor et Fides, 1973).
4 brèves synthèses pour memoire sur :
 Son prix Nobel
Son prix Nobel
Albert Camus a vécu une enfance de pauvreté, élevé entre sa grand-mère et sa mère à qui il a d’ailleurs toujours été reconnaissant. La figure maternelle occupe une place centrale dans l’œuvre de Camus. Il dédicace Le Premier Homme à sa mère : « A toi qui ne pourras jamais lire ce livre », car elle était analphabète. Il n’y a pas beaucoup de prix Nobel de littérature (1957 – il avait 44 ans) qui aient eu comme parents un ouvrier sans qualification et une femme de ménage d’origine espagnole. Il a reçu ce prix « pour son importante œuvre littéraire qui met en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. » Cela dit très bien l’intérêt que suscite encore Camus chez beaucoup de gens. Contrairement à ce qu’on dit, son œuvre n’a pas pris une ride. Au contraire, on a même retrouvé une certaine actualité dans ses réflexions, sur la question politique notamment.
Ses engagements
Camus n’a cessé de dire qu’il restait de gauche mais il n’a pas été compris quand il a critiqué le communisme et s’en est éloigné. On vivait alors dans un climat d’idolâtrie intellectuelle envers le communisme. Il a eu le courage de se démarquer d’un certain nombre d’intellectuels, ce que certains, dont Sartre, ne lui ont pas pardonné. Camus s’est aussi vigoureusement opposé à la peine de mort. Il a écrit en 1957, conjointement à l’essai d’Arthur Koestler, « Réflexions sur la pendaison », des « Réflexions sur la guillotine », essais publiés sous le titre : « Réflexions sur la peine capitale ». Il fut enfin l’un des rares intellectuels, en 1945, à avoir dénoncé l’horreur d’Hiroshima dans le journal Combat.
Sa vision de l’humanisme
Camus n’aimait guère le terme d’humanisme. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’était pas un humaniste ! Pascal déjà disait que « la vraie morale se moque de la morale » ! On pourrait dire analogiquement que le véritable humanisme se moque de l’humanisme. Camus écrivait dans ses « Carnets » : « L’humanisme ne m’ennuie pas, il me sourit même. Mais je le trouve court ». Ou encore : « Il paraît qu’il me reste à trouver un humanisme. Je n’ai rien contre l’humanisme bien sûr, je le trouve court voilà tout ! » De même il dit : « Humanisme, je n’aime pas l’humanité en général, je m’en sens solidaire d’abord, ce qui n’est pas la même chose ». Il émet donc de sérieuses réserves quant à l’usage du terme d’humanisme concernant sa philosophie de l’homme sans Dieu. Il y a, selon lui, dans le terme d’humanisme le risque d’une philosophie béate, d’une philanthropie plate faisant abstraction du problème du mal. Sa réserve est surtout liée au risque d’abstraction que peut véhiculer ce terme en « isme ». Or, Camus n’a cessé de dénoncer des formes d’humanisme qui, sous les apparences d’une révolte généreuse, préfèrent un homme abstrait, ou encore un homme reflet, comme il écrit, à l’homme de chair. D’où sa critique très forte du communisme puisqu’il détecte dans une certaine vision du communisme un messianisme sans Dieu délétère : négation de l’homme de chair au profit d’une humanité abstraite. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la formule : « Je défendrais ma mère avant la justice ». Camus rappelle que, par rapport à l’exercice d’une violence au nom de fins prétendument justes, il faut aussi prendre en compte l’homme de chair, celui qui mérite mon amour au présent, ici et maintenant, et qui a un visage, pourrait dire Levinas.
Son rapport à la philosophie
On a parlé de Camus comme philosophe pour classes terminales ! Certes, Camus n’était ni un philosophe universitaire, ni un philosophe de profession. Il n’a d’ailleurs jamais prétendu à ce titre. Le fait est qu’atteint de tuberculose, il n’a pu se présenter à l’agrégation de philosophie et qu’il n’a pas la rigueur conceptuelle de Sartre ou de Merleau-Ponty. Son projet est tout autre. Comme le rappelait Paul Ricœur à propos de L’Homme révolté, Camus est incontestablement un penseur, et, en un sens, philosophe ! Voici ce que Camus écrit lui-même dans les Carnets : « Les anciens philosophes et pour cause réfléchissaient beaucoup plus qu’ils ne lisaient. C’est pourquoi ils tenaient si étroitement au concret. L’imprimerie a changé ça. Evidemment il dit ça, cum grano salis, non sans ironie. On lit plus qu’on ne réfléchit. Nous n’avons pas des philosophies mais seulement des commentaires. C’est ce que dit Gilson en estimant qu’à l’âge des philosophes qui s’occupent de philosophies, a succédé l’âge des professeurs de philosophie qui s’occupent des philosophes. Il y a dans cette attitude à la fois de la modestie et de l’impuissance. Et un penseur, je souligne qui commencerait son livre par ces mots : prenons les choses au commencement, s’exposerait aux sourires. C’est au point qu’un livre de philosophie qui paraîtrait aujourd’hui en ne s’appuyant sur aucune autorité, citations, commentaires, etc., ne serait pas pris au sérieux. Et pourtant… » Trois points de suspension. Comme le rappelait Pierre Hadot, professeur au Collège de France, dans Qu’est-ce que la philosophie antique ?, notre conception moderne de la philosophie, influencée par les nécessités de l’enseignement universitaire, n’a plus grand-chose à voir avec la philosophie des anciens. Il faut bien voir qu’avant tout la philosophie est un art de vivre. Le discours philosophique prend son origine dans un choix de vie et une option existentielle, et non l’inverse. Au fond, il s’agit de s’entendre sur la manière dont on conçoit la philosophie, voilà tout !
Tous nos remerciements à Radio Réveil et Paroles de Vie
Edition : Association Radio Réveil 2022 Bevaix (Suisse)
Internet : ** Voir le site : www.paroles.ch **
